Nos artistes
Gustave ALAUX (1816-1882)
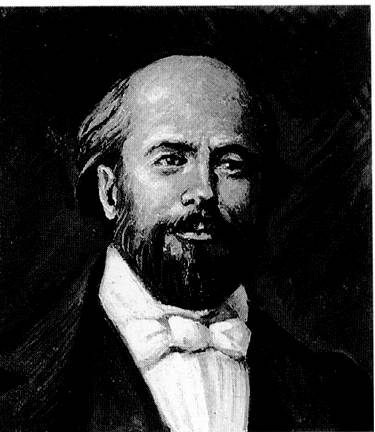
Quand M. Thiac, architecte du département de la Gironde, construisit le palais de justice, Gustave Alaux lui fut attaché comme dessinateur écrivain, et lorsqu’on entreprit l’édification des prisons, il changea son titre en celui d’inspecteur ; M. Gautier, de Libourne, le remplaça comme dessinateur ; l’inspecteur touchait 1 200 francs par an, le dessinateur, 900. En 1844, les travaux des prisons étaient achevés. Riche de ce qu’il avait pu économiser de son maigre traitement, il partit pour Paris où il fit un séjour d’un an.
Après avoir dirigé la construction des ponts de Groslejac, Siorac et Sarlat, il entra franchement dans la pratique de l’architecture, et dès ses débuts, un instinct du pittoresque, un amour de la forme et de la couleur que nous attribuons volontiers à ses origines de peintre et de décorateur, le portèrent résolument du côté de l’architecture du moyen âge, dont il devint l’un des adeptes les plus fervents. Les relations qu’il lia avec MM Violet le Duc, Lassus et Vaudoyer ne firent que confirmer sa sympathie pour cette forme de l’architecture et il y a produit des œuvres importantes et pleines d’intérêt.
Sa renommée prit son origine dans la Gironde et le Lot-et-Garonne ; elle s’étendit rapidement dans les Landes, la Charente et la Charente Inférieure (aujourd’hui Charente-Maritime).
Il a construit ou restauré environ 70 églises ou chapelles : on peut citer comme d’excellents types : Arcachon, Saint-Ciers-Lalande, Mérignac, Bon Encontre, Aiguillon, Buglose, Mugron, Mortagne, Saint-Genis, la chapelle des Bénédictins à Saint-Jean-d’Angély, les Dames Blanches à La Rochelle et bien d’autres.
Les châteaux du Mont Cassin, de Saint-Bernard, de Saint-Mesgrin, de Las Tours, de Saint Genès, de Goulens sont des constructions originales, un peu personnelles, et où l’artiste a intelligemment adapté les formes du Moyen-âge aux exigences de la vie et du confortable moderne. Les plans sont commodes, simples à comprendre, ce qui donne une habitation agréable ; les façades sont mouvementées, animées par des décrochements parfois cherchés et souvent réussis. Le jeu des combles y est ménagé avec grand soin, et quand il s’est agi de planter le bâtiment, d’en choisir la place, l’artiste a généralement fait preuve d’une grande sûreté de coup d’œil, d’une véritable entente du concours que le château ou l’église devaient emprunter au paysage en retour de ce qu’ils lui apporteraient.
C’est la permanence de cette qualité maîtresse qui nous faisait dire que chez Gustave Alaux, les instincts du peintre et du décorateur avaient été un puissant appoint aux aptitudes de l’architecte. Il est impossible de méconnaître les difficultés que présentaient l’exécution des travaux de ce genre, à une époque, dans des localités parfois hors de portée des grandes villes, où tout manquait : matériaux et ouvriers. Ces difficultés, Gustave Alaux les surmonta avec beaucoup d’intelligence et contribua pour une grande part à l’éducation professionnelle de quelques industriels ou artistes qui sont devenus, à leur tour, des sortes de chef d’école et ont fourni des ouvriers habiles. Sculpteurs, menuisiers, marbriers, peintres, ferronniers, serruriers, verriers, tapissiers se sont rapidement façonnés à ces formes, à ces procédés anciens qui exigent du soin et de l’habileté et qui ont produit tant d’œuvres devenues curieuses et dont l’imitation décourage parfois l’industrie moderne.
Signalé de bonne heure à l’attention par ses aptitudes et son talent, Gustave Alaux fut appelé par la Compagnie du Midi à participer à la création de la ville d’hiver à Arcachon.
Il fut nommé en 1857 membre de la Commission des monuments historiques et des bâtiments civils de la Gironde ; il avait si bien pris droit de cité dans le Lot-et-Garonne que le préfet de ce département l’appela à y faire partie de la Commission des bâtiments civils.
Dans la Gironde, il fut chargé des travaux des bâtiments départementaux pour les arrondissements de La Réole et de Lesparre. Il fut, en 1863, l’un des fondateurs de la Société des Architectes de Bordeaux qu’il présida de 1873 à 1875. Il était chargé à Bordeaux des travaux de la Banque de France.
La grande activité que nécessitait sa vie laborieuse ne l’empêchait pas de cultiver, avec la peinture et l’architecture, les arts et les exercices du corps et de l’esprit.
Passionné pour la musique, même avant sa grande amitié avec Charles Gounod, il aimait la chasse, l’escrime, la natation. Causeur d’autrefois, esprit fin, nourri de littérature, railleur discret. C’était encore un ami sincère et celui qui retrace de lui ce portrait rapide se rappelle avec émotion cette liaison affectueuse aussi longue que la vie et que ne purent troubler ni l’éloignement, ni une certaine différence d’âge, ni même les inévitables chocs du début de deux carrières semblables. Gustave Alaux était un homme de talent et de cœur.
Mais au moment où toute espérance semblait permise pour l’avenir, un coup inattendu vint ébranler l’édifice si patiemment élevé.
En 1876, alors qu’il s’occupait avec sollicitude de parfaire l’éducation de ses enfants, veillant attentivement sur ses fils, dont l’un était architecte et les deux autres peintres, comme pour perpétuer la tradition de la famille, Gustave Alaux fut atteint d’un mal qui brisait à la fois sa main et sa pensée. Il sentit profondément le coup, le dit à ses amis, et ne voulant pas trop attrister les siens, il se résigna et bientôt quitta Bordeaux pour aller à Arcachon où il espérait retrouver la santé. Mais le mal, qui eût d’abord l’air de céder, ne faisait que lui donner relâche, et longuement, lentement, sans crise violente, il s’éteignit.
Dans cette longue agonie, il était toujours attiré et charmé par les beautés de la forme et de la couleur qui avaient eu tant de places dans sa vie. Il peignait des fleurs, des oiseaux, des papillons, trouvant toujours la couleur vraie, la coloration juste, ravi quand il croyait son œuvre bonne, heureux de la montrer. L’art auquel il avait donné toute sa vie lui était en retour fidèle jusqu’à son dernier jour et on peut dire que c’est lui qui a clos ses yeux.
© Charles Durand, architecte. Notice biographique. Février 1885.
Chevalier de la Légion d’honneur.